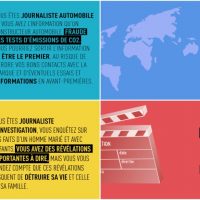Stéphanie Fontenoy, correspondante pour des médias belges et français aux États-Unis.
Photo: Stéphanie Fontenoy
Originaire d’Ottignies, elle a suivi sa famille en France dès l’âge de six ans. Après un diplôme en sciences du langage à l’Université de Bordeaux, elle se lance dans un master en journalisme à la City University of London. Il y a dix ans, elle décide de s’installer à New-York pour vivre sa grande histoire d’amour avec la ville qui ne dort jamais. Rencontre avec une mordue de l’actu qui vit au rythme effréné de deux continents.
Comment vous êtes vous retrouvée à New-York ? Hasard, choix ou obligation professionnelle ?
Choix ! J’ai toujours nourri l’ambition de parcourir le monde. New-York m’a immédiatement marquée lors d’un voyage touristique. J’ai eu le coup de foudre pour cette ville. Je me suis dit qu’un jour, j’y vivrai. En 2003, quand la crise a frappé la rédaction de la RTBF où je travaillais depuis 2000, j’ai dû partir car je ne disposais pas de contrat fixe. Au début, j’ai cru que tout s’effondrait autour de moi. Puis, je me suis ressaisie et me suis dit que c’était l’occasion rêvée pour partir à la découverte de New-York. En février 2004, je me lançais. À peine débarquée, je couvrais l’élection présidentielle et écrivais des piges pour le journal La Libre Belgique. J’ai décidé de ne plus repartir !
Pour quel média travaillez-vous aujourd’hui?
Je suis journaliste indépendante. Je continue à faire des piges pour le quotidien La Libre. C’est le média principal pour lequel j’écris. Mais je travaille aussi pour des médias français, dont le journal La Croix et le quotidien régional Sud Ouest. Dans le passé, j’ai écrit une rubrique hebdomadaire dans L’Écho et Le Vif/L’Express.
« Vivre à New-York au quotidien permet de saisir toutes les facettes de la ville. »
Comment gérez-vous la relation avec vos employeurs belges et français depuis New-York?
La première difficulté est que je dois me calquer sur les heures de travail belges et françaises. Je dois tenir compte de ce décalage. En général, je dispose de quatre ou cinq heures pour écrire un article. Ma matinée est donc consacrée à la rédaction des sujets. L’après-midi, je l’utilise pour obtenir de la matière pour mes articles, me documenter, prendre des rendez-vous… C’est donc toute une organisation. Le deuxième point important est d’avoir une bonne entente avec ses employeurs. N’étant pas physiquement dans la rédaction, je suis à la fois très libre de mes choix mais je dois aussi m’accorder avec mes chefs, sachant que chaque journal a des attentes différentes. Je n’écris pas de la même manière dans les différents journaux ni sur les mêmes sujets.
Comment peut-on, en tant que correspondante, intéresser un public européen à l’actualité étrangère ?
En gardant toujours cette question à l’esprit : quel fait de société, quel événement peut avoir des répercussions en Europe ? Ce n’est pas un mythe de dire que ce qui naît aux États-Unis dérive ensuite souvent vers la Belgique. Que ce soit des questions politiques, éthiques, sociales… L’idée est de sélectionner en priorité ce qui intéresse le public belge et français.
Beaucoup de rédactions en Belgique travaillent désormais majoritairement depuis Bruxelles sur des dossiers américains. Selon vous, quels sont les avantages d’être correspondant ?
Le fait d’être présente jour et nuit dans cette ville en constante mouvance, de respirer l’Amérique dans son quotidien est un énorme privilège. On finit par ressentir les effluves de la ville et en saisir toutes ses nuances. Aucune interview téléphonique, aussi bonne soit-elle, ne saurait égaler pareille sensation.
Les différentes facettes dont vous parlez justement, sont-elles la raison qui vous pousse à rester?
On imagine souvent New-York comme une ville qui grouille de monde, uniquement là pour travailler. C’est tellement plus que cela. Il y a une telle diversité dans les âges, les personnalités… Où qu’on soit, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, il va toujours se passer quelque chose. C’est toute la magie. On ne s’ennuie jamais, on ne peut pas se sentir seul. Il me reste environ trente ans de carrière devant moi et cette envie de parcourir un autre coin du monde est bien présente. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Je ne m’imagine qu’à New-York pour l’instant.
« C’est comme si ma production journalistique avait désormais autant de valeur qu’un Mc Do. »
Quel est l’impact de la crise économique vécue dans les rédactions sur votre quotidien de correspondante ?
Théoriquement, je suis amenée à me déplacer plus que ce que je ne le fais en ce moment. Mais avec les budgets serrés des rédactions, c’est très compliqué. Dernièrement, j’ai dû couvrir le gros dossier sur les immigrés d’Amérique. Je n’ai pas eu le budget pour voyager. J’ai donc dû composer avec les intervenants dont je disposais à New-York mais qui, malgré tout, devaient rendre compte d’une réalité nationale.
Et sur le plan privé ?
Pour vous donner une idée, je gagne le même salaire qu’une femme de ménage aux États-Unis. Journaliste, pourtant un métier soi-disant intellectuel pour lequel on doit faire des études, n’est pas du tout reconnu. Vivre du journalisme quand on n’est pas salarié est devenu très compliqué. La valeur de la pige aujourd’hui ne correspond pas aux réalités du coût de la vie. Je suis payée environ 150 euros pour un article d’une page, que je mettrai un ou deux jours à écrire. Ce qui fait environ une dizaine d’euros de l’heure. C’est comme si l’information que j’écrivais avait autant de valeur qu’un McDonald’s. Le contenu journalistique est devenu un produit banalisé, à très basse valeur ajoutée. Je n’avais jamais imaginé devenir riche en faisant ce métier mais, à ce point, c’est interpellant. Je pense qu’on devient journaliste par passion. Ma vie c’est mon travail, mon travail c’est ma vie. Je ne fais pas de distinction.